Vous parcourez peut-être ces lignes parce que vous venez de lire le billet publié dans Le Monde, à la une du cahier « Sciences & Technos » du samedi 17 mars 2012, et que vous avez voulu en savoir un peu plus ? Alors bienvenue !
Le format de cette « carte blanche » oblige à la concision, et ne permet guère ni de créditer ni a fortiori de citer de façon suffisamment détaillée les recherches et les publications sur lesquelles je me suis appuyé pour la rédiger. Les sciences sociales, comme les autres sciences, ne sont pas le produit d’un exercice solitaire et en apesanteur de la pensée. Aussi, tant que durera cette tribune, je vous propose de retrouver ici, sur ce blog, au moment de la parution de chacune de ces « cartes blanches », un billet plus long dans lequel j’essaierai de développer mon propos, d’apporter un certain nombre de compléments, de pistes supplémentaires de réflexion… et surtout des suggestions de lectures : ce sera aussi une façon de rendre à mes collègues ce que je leur aurai emprunté pour écrire ces courts billets ! Pour cette fois, la version longue de cette carte blanche intitulée « Des équipements et des laboratoires » ne va pas être excessivement plus longue que la version parue dans Le Monde. Je vais tout juste me contenter d’apporter quelques précisions, et surtout quelques liens vers les équipements que j’y évoque…
Dans cette carte blanche, ma réflexion partait d’une idée très largement répandue dans l’opinion, qui veut que la recherche en sciences humaines et sociales n’a pas de besoins financiers très importants, contrairement aux sciences expérimentales. Aux yeux du public, domine toujours la figure, toujours individuelle, souvent solitaire, de l’historien plongé dans les archives avec le temps et la patience pour seules ressources indispensable, ou de l’ethnologue dont tout l’équipement pourrait se résumer à un carnet et un crayon. Quant au sociologue, ses enquêtes, même quand elles sont réalisées par questionnaires auprès de plusieurs centaines de personnes, resteraient d’un coût modeste (quelques milliers d’euros). Et à cela, il faut ajouter que cette image a pu être en partie entretenue de l’intérieur des sciences sociales, par un certain nombre d’intellectuels qui avaient beaucoup à gagner à mettre ainsi en scène une sorte de vœu de pauvreté matérielle qui ne pouvait que contribuer à l’héroïsation de leurs contributions.
Certes, les sciences sociales n’ont pas besoin d’accélérateurs de particules de plusieurs dizaines de kilomètres de circonférence, ni d’envoyer des télescopes dans l’espace. Mais les progrès dans la connaissance des sociétés ont tout de même un coût, qui peut ne pas être négligeable, contrairement donc à une croyance tenace. Et en réalité, pendant que nous continuions à nous bercer de cette illusion de la gratuité du savoir en sciences humaines et sociales, voire à l’entretenir sciemment, nous avons pris un grand retard dans certains domaines, par comparaison en particulier l’Amérique du nord de nombreux pays européens : aux Etats-Unis, au Canada, en Angleterre ou en Allemagne notamment, on a compris depuis assez longtemps la nécessité de développer des équipements parfois coûteux au service de la production et de la diffusion de la recherche en science sociales.
Un article de Christian Morrisson constatait déjà il y a près de quarante ans le manque de moyens humains, matériels et financiers dont souffraient à l’époque les sciences sociales en France (« Les moyens des sciences sociales en France », Revue économique, volume 26, n°6, 1975, pp. 1004-1023). Des taux d’encadrement et des dépenses par étudiant beaucoup plus faibles le démontraient déjà : alors que les sciences sociales avaient des besoins importants en matière de missions, d’enquêtes, de banques de données, de documentation, ces besoins n’engendraient absolument pas des budgets comparables à ceux dont bénéficiaient les sciences expérimentales et les sciences fondamentales. Et de façon assez remarquable, Christian Morrisson pointait déjà, à l’époque, le handicap lourd que constituait pour les sciences sociales françaises l’absence de politique ambitieuse d’accès aux données des grandes enquêtes de la statistique publique.
Quelques progrès ont bien sûr été faits depuis : Christian Morrisson lui-même signalait déjà l’amélioration – très relative toutefois – de la situation matérielle des sciences sociales françaises après 1968. Ces progrès sont lents, et par exemple le retard de la France est longtemps resté très important en matière d’archivage et de diffusion des données, comme le signalait le rapport de Roxane Silberman sur Les sciences sociales et leurs données (1999). A la suite de ce rapport, une politique plus ambitieuse s’est finalement mise progressivement en place en France, à partir du début des années 2000 et de la création du Réseau Quételet.
Ce que je voulais surtout signaler dans cette carte blanche, c’est que de ce point de vue le mois de février dernier a apporté deux bonnes nouvelles, qui peuvent aider la France à continuer de combler une partie de son retard, en la dotant enfin d’équipements scientifiques cohérents tout au long de la chaîne de la recherche. A un bout de cette chaîne, du côté de la production des données, la première bonne nouvelle c’est l’inauguration, le 2 février dernier, de « l’équipement d’excellence Données, Infrastructures, Méthodes d’Enquêtes en Sciences humaines et sociales » (DIME-SHS), porté en particulier par Sciences Po, et doté de 10 millions d’euros. L’objectif de DIME-SHS est de doter enfin la France d’un véritable « centre d’enquêtes » sur le modèle anglo-saxon des Survey Research Centres, avec un triple dispositif : un centre d’archivage des données des enquêtes qualitatives, une plateforme de services pour la collecte des données à partir du web, et un dispositif de réalisation d’enquêtes par questionnaires. Le plus : les chercheurs en sciences sociales, qui devaient auparavant faire appel à des instituts de sondage privés, pourront désormais disposer avec ELIPSS (Étude Longitudinale par Internet Pour les Sciences Sociales) d’un outil unique au monde : un panel de 6000 individus équipés de tablettes numériques et de connexions à Internet mobiles, en échange de leur participation régulière à des enquêtes sélectionnées par un conseil scientifique parmi les candidatures déposées par les équipes de recherches (quelques détails supplémentaires dans ce diaporama au format PDF). Alain Chenu et Laurent Lesnard[1] insistent beaucoup, dans leur récent livre (La France dans les comparaisons internationales, 2011, dont j’ai fait un compte rendu dans Lectures) sur le manque d’un véritable dispositif d’aide logistique aux enquêtes à la disposition des chercheurs : avec DIME-SHS, c’est une partie de ce manque qui se comble.
A l’autre bout de la chaîne, du côté de la diffusion de la recherche et de la médiation scientifique, la seconde bonne nouvelle, toute récente elle aussi, c’est que le projet OpenEdition vient à son tour d’accéder au rang d’équipement d’excellence, ce qui lui permet de disposer d’un budget total de 7 millions d’euros sur les huit prochaines années. OpenEdition, c’est la plateforme française d’édition et de diffusion électroniques pour les sciences humaines et sociales, qui articule entre eux déjà entre eux dispositifs : Revues.org, qui diffuse aujourd’hui plus de 300 revues scientifiques ; Calenda, l’agenda qui publie chaque année des milliers d’annonces scientifiques ; et Hypotheses, la plateforme des blogs de chercheurs, dont le succès, depuis son lancement en 2007, ne se dément pas. A ces trois outils va s’en ajouter très vite un quatrième : OpenEdition Books, qui ambitionne de mettre à disposition du public 15.000 ouvrages universitaires. Le label et le budget ainsi obtenus vont permettre à OpenEdition de se lancer dans la construction d’une bibliothèque électronique internationale en libre accès, dédiée aux sciences humaines et sociales, à même de rivaliser avec les initiatives anglo-saxonnes de même genre[2].

L'équipe d'OpenEdition, lors de l'université d'été du Centre pour l'édition électronique ouverte (Marseille, septembre 2011)
D’un côté, ces deux nouveaux équipements[3] sont une bonne nouvelle pour les sciences sociales, et cela d’autant plus que dans les deux cas, le sentiment est qu’ils donnent à la recherche française les moyens de défendre une vocation de « service public » à laquelle beaucoup sont attachés, et en s’appuyant de façon déterminée sur les possibilités offertes par Internet et les nouvelles technologies pour favoriser le partage et la diffusion des connaissances. Mais la médaille a son revers : aujourd’hui, cette politique de grands équipements scientifiques est financée à moyens constants, c’est-à-dire en prélevant les moyens dont ils sont dotés sur les budgets de fonctionnements de l’enseignement supérieur et de la recherche. Autrement dit, pour développer ces équipements d’excellence, on détruit petit à petit le CNRS et les laboratoires, qui sont pourtant les seuls lieux d’une politique cohérente et ambitieuse de formation à la recherche, et les instances privilégiées de la production scientifique. La politique des équipements d’excellence pousse les murs, mais elle démonte le plancher[4]. Nous avions des chercheurs sans équipements, mais qu’aurons-nous vraiment gagné si à la place, nous avons des équipements sans chercheurs ?
Références bibliographiques
Cardon Dominique (2010), La démocratie Internet. Promesses et limites, Paris, Seuil, coll. « La République des Idées »
Chenu Alain et Lesnard Laurent (2011), Guide d’accès aux grandes enquêtes statistiques en sciences sociales, Paris, Les Presses de Sciences Po
Morrisson Christian (1975), « Les moyens des sciences sociales en France », Revue économique, vol. 26, n° 6, pp. 1004-1023. Voir en ligne: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/reco_0035-2764_1975_num_26_6_408241
Silberman Roxane (1999), Les sciences sociales et leurs données. Rapport de mission au Ministre de l’Education nationale, de la recherche et de la technologie, Paris, La Documentation Française, 193 p. Voir en ligne: http://www.education.gouv.fr/cid1925/les-sciences-sociales-et-leurs-donnees.html
[1] Ce dernier est le responsable de DIME-SHS.
[2] Je dois à la vérité d’ajouter qu’il se trouve que je suis depuis 2010 membre du conseil scientifique du CLEO, l’unité du CNRS qui développe OpenEdition, et que je suis également membre, depuis le début de l’année, du conseil scientifique d’ELIPSS. Mais ce n’est pas parce que j’ai accepté ces deux invitations à participer à leur orientation scientifique que je trouve qu’il s’agit d’initiatives importantes ; c’est au contraire parce qu’elles me semblaient importantes que j’ai accepté avec plaisir ces invitations !
[3] L’écart avec les sciences dites « exactes » n’est pas près d’être comblé : au total, sur la cinquantaine d’équipements d’excellence lauréats lors de la première vague, seulement cinq concernaient les sciences humaines et sociales, avec une dotation de moins de 30 millions d’euros sur les 350 millions alloués à l’ensemble du programme. Les quatre autres équipements pour les sciences sociales, avec des dotations inférieures à celles de DIME-SHS et d’OpenEdition, sont le CASD (Centre d’accès sécurisé distant), D-FIH (Données financières historiques), MATRICE et NewAglae (Nouvel accélérateur Grand Louvre d’analyse élémentaire, dédié à l’archéologie). Lors de la deuxième vague, qui a qualifié 36 équipement pour une dotation globale de 210 millions d’eurors, les sciences humaines et sociales ont obtenu cinq équipements d’excellence supplémentaires, parmi lesquels le dispositif de suivi de cohorte ELFE, sur lequel je reviendrai sûrement prochainement.
[4] Cette chouette métaphore n’est pas de moi : je l’ai volée à Dominique Cardon, qui l’utiliser dans l’introduction de La démocratie internet (2010), page 10, pour évoquer les conséquences d’internet sur l’effacement des frontières entre espace public et espace privé.

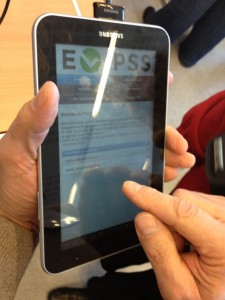










{ 2 commentaires… lisez-les ci-dessous ou ajoutez un commentaire }