Il y a quelques jours, j’ai été sollicité par l’équipe « Economie et Statistiques » d’un grand cabinet d’études[1], qui est commanditée par la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) pour réaliser une étude sur « l’évolution des pratiques de partage et le panier moyen de consommation de biens culturels de l’ère pré-numérique à nos jours », en partenariat avec un collègue sociologue, chercheur au CNRS. Cette étude doit permettre à l’HADOPI de connaître l’évolution des pratiques culturelles depuis les années 80, et en particulier l’évolution des pratiques de partage, du volume de biens partageables, de biens partagés, et de la facilité à les partager…
Dans le cadre de cette étude, l’entretien pour lequel j’étais sollicité visait à recueillir mon éclairage sur un certain nombre de questions autour des usages d’internet et de la culture. Comme le précisait la grille d’entretien qui m’avait été communiquée, il s’agissait de me demander notamment comment avaient évolué la notion de pratique culturelle depuis trente ans, et la distinction entre activité de communication et activité culturelle ; comment avaient évolué les modalités d’acquisition, de copie, d’échange et d’utilisation des contenus culturels ; quels étaient les médiateurs qui orientaient les choix, permettaient la découverte des œuvres, en facilitaient l’accès, accompagnaient les consommations ; quelles relations entretenaient désormais les activités culturelles « en ligne » et les activités « hors ligne », et plus généralement comment les transformations technologiques affectaient les pratiques culturelles, etc., etc.
Après quelques jours de réflexion, j’ai décidé de ne pas répondre favorablement à cette demande d’entretien, et donc de ne pas participer à cette étude. Si je prends la peine ici d’expliquer rapidement la raison de ce refus, ce n’est pas tant qu’il me faille m’en justifier personnellement, ce qui n’a guère d’intérêt ; c’est surtout que derrière cette raison, il y a, me semble-t-il, un certain nombre de problèmes dont il ne serait pas inintéressant de débattre…
Enfreignant la plus élémentaire des règles de prudence, qui veut que « Devant l’Hadopi, le silence est la meilleure des défenses », je tente donc une explication. Ce n’est pas le fait de recourir à un cabinet d’études privé qui est en cause, ni la qualité ou la rigueur du travail qu’il pourrait réaliser : la réalisation de nombreuses enquêtes de la statistique publique française est« sous-traitée » à des entreprises privées, et dans les cas que je connais, le résultat obtenu n’est ni plus ni moins discutable que ceux obtenus par exemple par l’INSEE. En attendant la montée en puissance de DIME-SHS (voir ce précédent billet), l’absence de véritables « centres d’enquêtes » publics en France explique l’existence d’un marché privé dans ce domaine, qui rassemble souvent de réelles compétences et constitue d’ailleurs un débouché possible pour les études en sciences sociales.
N’est pas non plus en cause du tout la personnalité scientifique du collègue du CNRS qui coordonne l’étude : il est au contraire connu pour la rigueur de ses travaux, et justement pour son engagement pour le développement d’un service public de la recherche en sciences sociales, auquel j’adhère entièrement.
Non, en réalité, et vous l’aurez peut-être deviné, mon problème, et la raison de mon refus, tiennent au statut du commanditaire de l’étude, l’HADOPI. Cette « Haute autorité » est un organisme public dont la mission est de lutter contre la copie et le téléchargement libres et gratuits de biens culturels (musiques, films, livres) protégés par le droit d’auteur. Je suis défavorable à la conception du droit d’auteur sur laquelle s’appuie cette mission, mais là encore, ce n’est pas le problème. Le problème véritable, c’est qu’à mon sens il y a une grave confusion dans le fait qu’une institution au moins normative (sinon clairement policière), chargée d’une mission qui conduit à la sanction judiciaire des contrevenants à une règle qu’elle doit promouvoir, puisse en même temps être la commanditaire d’une étude indépendante, dont les conclusions peuvent possiblement porter sur le bien-fondé économique et social de cette règle.
Une partie de la tradition sociologique s’est inaugurée par l’établissement d’une distinction inconciliable entre « le savant » et « le politique »[2]. On peut évidemment discuter l’intransigeance de la position wébérienne, mais pas au point de se prêter au jeu de l’alliance entre le savant et le policier qui sous-tend la sollicitation qui m’a été adressée. Ce n’est pas que les missions de police soient détestables par principe, c’est qu’elles ne sont pas compatibles avec les missions scientifiques. Ainsi, comment peut-on à la fois prétendre étudier sans a priori les pratiques de partages, et en même temps proclamer « l’impasse du partage »[3] sur la page d’accueil de ses « labs » ? On dirait que l’HADOPI a déjà la réponse à sa question avant même de l’avoir posée…
Ici, concrètement, et malgré toutes les déclarations de principe imaginables, je ne dispose d’aucune garantie sur les usages de mes réponses, et plus généralement sur les usages de l’étude ainsi commanditée, de plus dans un contexte encore compliqué par la précarité de l’avenir proche de ladite institution.
J’ajouterais même qu’en réalité, j’ai quelques indices du manque de sincérité du commanditaire. La préparation de l’étude pour laquelle je suis sollicité avait fait en effet l’objet d’une consultation publique sur le site des « labs » de l’HADOPI, où chacun était invité à laisser des commentaires. Comme j’étais curieux de ces commentaires, je suis parti à leur recherche, et les ai trouvés ici. Il y en a en tout et pour tout 14, de 9 personnes différentes (dont au moins 3 membres identifiables de l’HADOPI). C’est que la consultation, qui prenait fin le 30 novembre 2011, a été annoncée publiquement… le 28 novembre 2011 ! Un des commentateurs se demande si ce ne serait pas « un peu foutage de gueule » ; et un autre croit avoir compris : « HEY MAIS ATTENDEZ… ca s’appelle pas faire de la politique ??? », se demande-t-il ? Oui, c’est bien de cela qu’il s’agit : l’HADOPI fait de la politique, et donc elle ne peut pas prétendre faire de la science. Ses études sont politiques, pas scientifiques. Je pourrais m’y prêter à deux conditions : 1. A condition de ne pas être sociologue, et 2. A condition d’être favorable à la politique ainsi défendue. Hélas, au moins une de ses deux conditions n’est pas remplie…
Pour finir, je n’ai pas pu m’empêcher de sourire en découvrant la page d’accueil des fameux « labs » d’HADOPI, reproduite ci-dessous : ceux-ci y sont présentés comme les « ateliers collaboratifs » de l’HADOPI, auxquels nous sommes tous conviés à participer… Mais juste en dessous, on remarque vite la mention : « L’accès à certaines fonctionnalités du site est temporairement désactivé, dont les commentaires. Merci de votre compréhension. » Etant donnée la conception de la collaboration ainsi affichée, vous comprendrez au moins en partie mes réserves !
[1]On pourrait dire qu’il est à la fois sérieux et jeune.
[2] Weber Max, 1963 [1919], Le savant et le politique, Paris, UGE, coll. « 10-18 », 185 p., introd. Raymond Aron. Voir en ligne: http://classiques.uqac.ca/classiques/Weber/savant_politique/Le_savant.html. Si une conception aussi restrictive du droit d’auteur que celle prévue par la loi et défendue par l’HADOPI était réellement mise en œuvre, alors je devrais être sanctionné pour la publicité faite à ce lien : les deux conférences de Weber ont été traduites en français en 1959 par Julien Freund, et ne seront donc libres de liens que 70 ans après la mort de celui-ci, soit en 2063 !
[3] Sous la plume par ailleurs très fumeuse, au moins ici, de « l’expert pilote » de l’HADOPI, Paul Mathias, suffisamment malin – ou prudent, étant données les incertitudes actuelles – pour éviter en réalité de prendre position de façon trop visible.

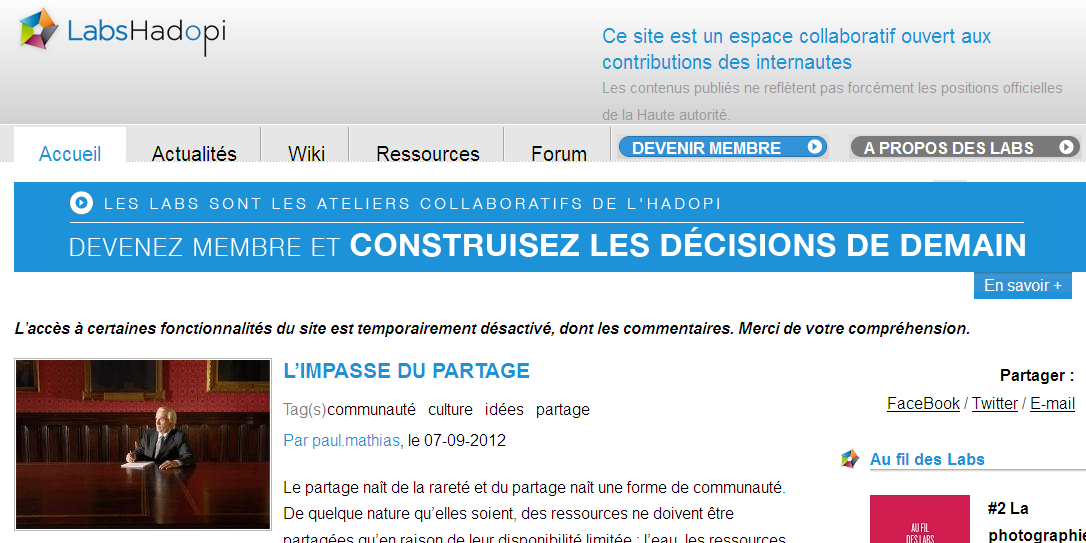










{ 7 commentaires… lisez-les ci-dessous ou ajoutez un commentaire }