Entre une observation ethnographique au stade de France mardi soir et un comité de rédaction de la revue Sociologie jeudi matin, j’ai profité d’un séjour parisien pour écouter les interventions rassemblées dans une journée d’études passionnantes, organisée donc ce mercredi 12 octobre 2011 sur le Campus Jourdan de l’ENS Ulm par Alexnadra Bidet et le « GDR Economie & Sociologie » du CNRS. Cette journée portait un titre un peu long : « Les classes sociales ont-elles été dissoutes par les socio-économistes dans les réseaux, les générations et la hiérarchie des revenus ? » (voir le programme ici), mais en gros, comme l’a expliqué Florence Jany-Catrice en préambule des interventions de la matinée, il s’agissait de se demander qui avait fait disparaître les classes sociales des modes de lecture du monde social traditionnellement mobilisés, en sociologie et ailleurs. Pour elle, la réflexion part d’un constat, celui de la marginalisation de la notion de « classes sociales » dans le vaste champ de la sociologie économique, au profit d’autres opérateurs, comme les réseaux, les générations, les centiles de revenu… Les intervenants ont donc eu pour consigne d’essayer d’interroger les fondements de cette marginalisation et ses enjeux, et le rôle d’une part des classements et des nomenclatures alternatives, et d’autres part des approches en termes de réseaux sociaux, dans cet effacement.
Comme Florence Jany-Catrice l’explique ensuite pour introduire les interventions de la matinée, en France on a longtemps disposé d’une nomenclature, d’un outil commode pour penser la stratification sociale, celui des PCS : un outil pensé pour le fordisme, mais multidimensionnel, dont l’efficacité tenait aussi sans doute à cela que les PCS était à la fois des catégories savantes et des catégories profanes, dont tout le monde pouvait s’emparer. Et c’est au recul du recours à cette nomenclature pour penser le monde social qu’on assiste aujourd’hui, dans un contexte où pourtant on assiste à la montée des inégalités sociales et à la baisse de la mobilité sociale. Comment expliquer ce paradoxe ? Ce recul est-il dû à une transformation ontologique du monde social, comme en particulier la montée de l’individualisme ? Ou bien à l’émergence de nomenclatures concurrentes, par exemple au niveau européen (ISCO, ESEC…) ? Ce serait alors tout autant la réalité qui se transformerait, que les outils à disposition pour en rendre compte… Mais cela ne dit rien de la capacité des sociétés à s’emparer de ces nouvelles nomenclatures, des représentations du monde social qu’elles véhiculent, et même des enquêtes qui pourraient les mobiliser… Pour préciser les contours et les enjeux de ces questions, la matinée se poursuit avec les interventions d’Alain Desrosières, d’Alain Chenu, de Thomas Amossé, de Cécile Brousse, d’Etienne Pénissat et de Luc Boltanski, que j’essaie de vous résumer assez succinctement ci-dessous…
Alain Desrosières :
A l’origine des « CSP », il y a le travail de Jean Porte, spécialiste de logique mathématique entrée à l’INSEE après la Seconde guerre mondiale. Chargé de l’exploitation du recensement de 1954, il était confronté à une demande de nomenclature, dans un contexte où le marxisme marquait profondément les sciences sociales. Jean Porte s’est efforcé, dans ce contexte, de faire un travail radicalement empirique, et essayant de regrouper des professions « qui se ressemblaient », et cela a donné la première nomenclature de ce que lui-même a appelé des « catégories socio-professionnelles ».
Parmi les traits essentiels de cette nomenclature, il y a l’idée qu’elle est profondément ancrée dans les structures conventionnelles de l’époque, même si cela n’avait pas été délibéré de la part de Jean Porte : c’est que ces structures étaient déjà, à l’époque, complètement naturalisées. Une autre originalité de la nomenclature française est d’avoir rapproché la nomenclature des métiers et la nomenclature des groupes sociaux. Autre point important, la nomenclature de Porte était à deux niveaux, un niveau agrégé à un seul chiffre, avec moins d’une dizaine de catégories, et un niveau agrégé à deux chiffres, avec une trentaine de catégories….
L’étape suivante intervient à la fin des 70’s, quand il s’est agi de remanier la nomenclature. Ce remaniement s’est appuyé sur un examen beaucoup plus précis des opérations de codage. Enfin, la troisième étape correspond au développement, aujourd’hui, d’une nomenclature européenne, moins « idiosyncratique » que celle de la France (tellement ancrée dans la spécificité du contexte français qu’elle ne peut pas être utilisée pour les autres pays) et appuyée sur des critères suffisamment universels pour pouvoir être généralisée.
Alain Chenu :
La question importante, pour comprendre les transformations dont il s’agit dans cette journée, est de déterminer quelles sont les institutions qui portent ou ont porté les représentations et les nomenclatures. Selon Alain Chenu, on peut distinguer de ce point de vue deux grandes périodes :
La première période va du Front populaire aux années 1970, et est marquée par la généralisation des conventions collectives, et l’extension progressive des classifications dites « Parodi-Croizat » aux différentes branches. Ce n’est pas un hasard si dans la première nomenclature, il y avait les mineurs, distingués par le fait qu’ils avaient une convention collective et une caisse de retraite spécifiques. Les artisans et les commerçants, qui n’ont pas voulu rentrer dans les caisses de retraite par répartition, sont aussi distingués par la nomenclature, et ceci ne peut pas être étranger à cela : la structuration d’une nomenclature n’est donc jamais étrangère aux singularités d’une histoire nationale de la protection sociale.
Dans la seconde période, à partir des années 70, on entre dans la construction d’un autre type de protection sociale, largement fondé sur la définition de minima sociaux, et qui ne renvoie donc pas à la spécification de branches professionnelles. Les institutions s’éloignent donc de ce qui était au cœur de la construction de la nomenclature des catégories socio-professionnelles. Par ailleurs, la massification scolaire est venue mettre à mal la ségrégation institutionnelle décrite par exemple par Baudelot et Establet dans L’école capitaliste en France (1971), ce qui est venu encore compliquer, et « dénaturaliser » la représentation de l’appartenance sociale par les nomenclatures traditionnelles. Ce mouvement est allé aussi de pair avec l’émergence dans les agendas internationaux de la distinction entre les immigrés et les nationaux. Les situations statutaires deviennent complexes, même au sein des classes populaires, comme dans le cas des conducteurs de bus étudiés par Olivier Schwartz dans le cadre d’une étude de très grande ampleur restée hélas pour l’instant inédite (je me permets ici un petit scoop rien que pour vous : elle ne sera plus longtemps inédite, guettez les prochains numéros de Sociologie… chut !).
Thomas Amossé :
A partir de son expérience de formateur des opérateurs de codage à l’INSEE, et d’analyste mobilisant les nomenclatures socio-professionnelles, Thomas Amossé revient sur un certain nombre de points soulevés dans les interventions précédentes :
1. L’outil CSP avait vocation à représenter la société sous la forme de groupes sociaux, mais sans reposer sur un fondement théorique. La posture théorique, « constructiviste », est intervenue ensuite, avec le travail de refonte piloté par Luc Boltanski, mais la nomenclature reste encore aujourd’hui un outil très largement « empirique ».
2. On a bien assisté à une montée des critiques adressées à la nomenclature des PCS, qui considèrent qu’elle serait de plus en plus obsolète (c’est-à-dire incapable de représenter les réalités des principes de structuration de la société française contemporaine), analytiquement impure (elle fait de la théorie des classes sociales sans le dire, et serait donc du point de vue économétrique une « mauvaise variable »), ou au contraire elle serait insuffisamment théorique, et manquerait la vocation de proposer une représentation en termes de classes sociales…
3. Ses usages sont, de fait, en déclin : les PCS sont de moins en moins mobilisées dans les travaux en sciences sociales, alors pourtant que les travaux empiriques montrent qu’elles ne sont pas moins pertinentes qu’auparavant, puisque les inégalités qu’elles permettent de repérer ne diminuent pas, au contraire. L’érosion de l’usage des PCS est même plus fort que l’érosion du sentiment d’appartenance de classe dans l’ensemble de la population.
Cécile Brousse :
Cécile Brousse, qui a été responsable à l’INSEE de la section des nomenclatures socio-professionnelles pendant les débats sur la construction d’une nomenclature européenne, commence son intervention en choisissant de prendre un peu le contrepied des critiques adressées depuis le début de la matinée à cette nomenclature. Pour elle, il faut d’abord se réjouir de la volonté d’aboutir à la construction d’une telle nomenclature.
Cela dit, elle souligne à quel point la construction de cette nomenclature se fait dans un contexte peu propice, où la tradition statistique consiste presque exclusivement à comparer les pays entre eux. C’est comme si toute la statistique socio-économique française se limitait à comparer les régions entre elles. C’est donc une question qui était assez peu investie à Eurostat, avec l’argument que les professions ne sont pas un critère suffisamment établi et harmonisé en Europe. Et de fait, de nombreux pays n’ont en réalité aucune nomenclature socio-économique des professions qui soit stabilisée.
Dans ce contexte, le mérite revient aux chercheurs dans le sillage de Goldthorpe d’avoir cherché à élaborer une nomenclature socio-professionnelle européenne. Ils se sont réunis en 2004 dans ce qui s’est appelé le consortium ESEC, et ont remis leur rapport en 2007. La nomenclature va s’appuyer sur la notion de « relation d’emploi », mesurant le degré d’autonomie du salarié, entre les deux extrêmes que sont le « labor contract », le subordonnant de façon stricte à l’employeur, et la « service relationship » (relation de service) marquée par une forte autonomie. Les catégories sont ainsi ordonnées sur cette échelle, selon 9 classes.
Il y a des points communs entre ESEC et les PCS : les artisans et les indépendants sont ainsi isolés et distingués dans les deux nomenclatures. Mais les différences sont nombreuses : on ne peut pas les citer toutes, mais par exemple, les chefs d’entreprise de plus de 10 salariés sont mélangés avec les cadres dans ESEC, ce qui est surprenant du point de vue des PCS…
A partir de 2007, les institutions de statistiques nationales ont eu à évaluer cette nomenclature ESEC. Les critiques ont été nombreuses : par exemple, ESEC serait mal adaptée aux pays du sud de l’Europe, où le critère de la relation d’emploi serait moins important que la distinction entre indépendants et salariés. Ou encore, le projet aurait vocation à proposer une grille universelle, mais en réalité il serait très « idiosyncratique »… à la société britannique. Pour d’autres chercheurs, on ne parvient pas à valider empiriquement la théorie de la relation d’emploi… Les critiques formulées par l’INSEE et la DARES portaient aussi sur l’absence de considérations en termes de pratiques culturelles ou de modes de consommation. Ensuite, on peut montrer que les relations d’emploi ne sont pas stables dans le temps, en particulier la catégorie de « superviseur » distinguée par la nomenclature ESEC est soumise à une très forte mobilité, ce qui pose problème pour la considérer comme une catégorie en soi. Dans un autre registre, Thibault de Saint-Pol a montré que la nomenclature est très peu heuristique pour analyser les pratiques culturelles. Enfin, l’INSEE s’est beaucoup intéressé à la réception de la nomenclature par le grand public, en partant d’un étonnement suscité par le fait que les intitulés de la nomenclature diffèrent dans la version pour les chercheurs et dans la version pour le grand public. Une enquête sur 4000 personnes a montré que 17% des enquêtés ne parviennent pas à s’identifier à une catégorie. Une autre enquête, à partir de jeux de cartes, montre que ce sont les cadres qui parviennent le mieux à se reconnaître dans la représentation du monde socio-professionnel proposé par la nomenclature ESEC (pour un certain nombre de ces critiques, voir Brousse, De Saint-Pol, Gleizes, Le Ru, Marical, Monso et Wolff, 2010).
Etienne Pénissat, à la suite de l’intervention de Cécile Brousse, présente les résultats d’une enquête, financée par l’ANR, sur la construction et la réception de la nomenclature européenne que vient d’évoquer Cécile Brousse. Il montre, en substance, que les conditions de production de cette nomenclature, et le débat qu’elle a suscitée, sont restés cantonnés dans le petit univers des socio-statisticiens, voire même dans les discussions entre administrateurs de l’INSEE et sociologues goldthorpiens.
Luc Boltanski :
Pour Luc Boltanski, on peut repartir du paradoxe, signalé par Thomas Amossé, entre le maintien des inégalités et la disparition des PCS et des représentations en termes de classes sociales. La question est au fond de savoir si on peut séparer l’objet et la façon de l’observer, ou s’il faut au contraire mettre l’accent sur la relation entre la réalité sociale et les catégories de l’observateur, dans une perspective constructiviste. Ici, on a certainement affaire, plutôt qu’à une construction sociale de la réalité, à une construction étatique de la réalité, tant le rôle des Etats est fondamental dans ce domaine.
On assiste actuellement à un nouveau tournant très intéressant, dont le benchmarking est un indicateur évident, et qui voit les instances de pouvoir, qui ont longtemps pesté contre un constructionnisme réputé de gauche, découvrir finalement que c’était vrai, et qu’on pouvait en réalité s’en servir, de ces instruments de connaissance, pour modifier la construction dans le sens qui leur convenait. Dans Le nouvel esprit du capitalisme (1999), Luc Boltanski rappelle qu’Eva Chiapello et lui avaient essayé de montrer que se sont mis en place tout un ensemble de mouvements de déconstruction des conventions, des syndicats, des institutions, qui sont à l’origine de la montée de l’individualisme.
Le problème, c’est que les outils sociologiques et statistiques sont en partie autonomes, puisque soumis à des contraintes liées à leur évaluation par les pairs, par la communauté scientifique, qui exerce une forme de contrôle. La sociologie est donc en partie « autonome », et les classes sociales, comme grille de lecture, ont mieux résisté en France que dans d’autre pays. Les classes sociales, sont des entités « sociologiques », et tout le travail sociologique a consisté à attribuer des propriétés à ces entités, voire à leur attribuer des intentions, comme dans ce type d’énoncés : « Les ouvriers supportent de moins en moins les cadences infernales ». Cela a contribué à chasser les agents individuels de la description des mécanismes sociaux, problème qu’a pensé résoudre la micro-sociologie, mais pour en soulever un nouveau qu’elle ne résoud pas, celui de l’agrégation macro-sociologique des comportements. Quant à l’analyse des réseaux, il suffit d’en examiner les fondements, par exemple dans les deux fameux articles de White, Boorman et Breiger (White, Boorman et Breiger, 1976 ; Boorman et White, 1976), pour voir qu’elle peut être, parfois donc explicitement, une machine à défaire les analyses en termes de catégories et de classes.
Les interventions de l’après-midi, tout en s’inscrivant dans la continuité des réflexions de la matinée, se concentrent ensuite, pour certaines d’entre elles, sur la question, soulevée notamment le matin en termes critiques par Luc Boltanski (et en partie reprises à son compte par Philippe Steiner dans son préambule introductif), du rôle de l’analyse des réseaux sociaux dans la marginalisation des approches en termes de classes sociales. J’ai malheureusement dû partir avant la fin, et ai donc manqué l’intervention de Frédéric Lebaron (pardon, Frédéric !) et la discussion générale, mais je vous propose tout de même un aperçu des propos tenus par Stéphane Beaud, François Dubet, André Orléan, Olivier Godechot et Emmanuel Lazéga…
Stéphane Beaud :
Stéphane Beaud, dans un propos qui s’inscrit dans la continuité d’un article sur les classes sociales paru dans la revue Mouvements en 2007, propose pour commencer de repartir du paradoxe déjà évoqué par les intervenants précédents, entre des inégalités et des conflictualités persistantes, et un désintérêt de plus en plus marqué de la sociologie pour les classes sociales. Or, les intérêts et les désintérêts des sociologues ont des effets sur la réalité sociale et ses représentations ordinaires. Par exemple, il n’est pas absurde de penser que les travaux des Pinçon-Charlot, de La vie dans les beaux quartiers (1989) au Président des riches (2010), ont contribué en partie à la diffusion de l’idée qu’il y avait bien une classe dirigeante en France, distincte des autres et consciente de ses intérêts.
Pour comprendre ce désintérêt, il faut d’abord s’intéresser à la formation des sociologues : les classes sociales ont progressivement disparu des maquettes des cursus de sociologie, où les étudiants se sont dans le même mouvement détournés de ce type de préoccupations, possiblement aussi parce qu’elles soulevaient des questions trop proches de leurs propres conditions sociales d’origine, auxquelles ils ne souhaitaient pas être rappelés.
Il y a ensuite d’importants enjeux de méthode, par exemple autour des rapports autour de la sociologie et des statistiques. Pour les statisticiens, les PCS ne sont plus fiables, coûtent cher à l’institution parce qu’elles nécessitent beaucoup de recodage, et ne sont plus très utiles. Cette position, très généralisée, contribue fortement à rendre plus difficiles les débats entre sociologues, économistes et statisticiens autour de ces questions, pourtant essentielles, des façons de représenter statistiquement le monde social.
Il y a enfin un troisième facteur, celui de l’injonction à « l’intersectionalité », autrement dit à la mobilisation combinatoire et multidimensionnelle des différentes catégorisations de classes, de genres et de races, dans laquelle les classes sociales, au-delà de la pétition de principe, sont en réalité très maltraitées.
François Dubet :
Pour François Dubet, ce désintérêt dont les intervenants se plaignent depuis le début de la journée est peut-être aussi l’effet en miroir d’un intérêt exagéré dans les décennies précédentes, où il a pu arriver qu’on mette les classes sociales à toutes les sauces. Ce qui faisait la force de la notion de classes sociales, c’est qu’elle permettait d’insister sur la dimension systémique du monde social. Et assez brutalement, c’est ce monde intellectuel qui a disparu. Mais la question peut être posée autrement : pourquoi, auparavant, ne voyait-on dans le social que des classes, et pas les principes de différenciation qui triomphent aujourd’hui dans l’interprétation du monde social, mais qui étaient pourtant déjà à l’œuvre alors : les âges, les générations, le genre, l’appartenance ethnique…
Ce qui ne fait aucun doute, c’est que concomitamment, la figure de la question sociale s’est transformée : elle est désormais dans la banlieue, elle n’est plus dans le monde ouvrier. Et à propos de celui-ci, l’exigence de justice sociale ne consiste plus à viser une réduction des inégalités, mais une égalisation des chances d’atteindre des positions inégales. On ne veut plus que les ouvriers aient des conditions de travail et un accès à la formation comparables à celui des cadres, on veut que les enfants d’ouvriers aient autant de chances que les enfants de cadres d’atteindre une position de cadre d’où ils pourront continuer à exploiter les ouvriers.
Nous sommes donc dans un système où perdurent des inégalités, de la violence, de l’exploitation, mais où tout cela ne se traduit pas dans des principes d’identification, du moins plus là où on les supposait ou attendait auparavant : avant, si je voulais me convaincre qu’il y avait des classes sociales, j’allais à Flins ; aujourd’hui, si je veux m’en convaincre, je vais à Neuilly…
André Orléan :
La question des classes sociales a été évacuée par une grande partie des économistes, au prétexte que nous sommes dans des économies de marché, et que le rapport marchand est une forme universelle qui est indifférente à ce type de spécifications. Cette thèse joue un rôle très structurant dans la pensée économique. Or, il semble à André Orléan que cette réduction du capitalisme à « l’économie de marché » ne tient pas, parce qu’elle exclut le rapport salarial de son champ.
Et ce qu’on constate, c’est une concomitance entre cette éviction du rapport salarial du mode de représentation de l’économie capitaliste, et une rupture dans le mode historique de répartition des gains de productivité : alors que pendant plusieurs décennies, ils ont bénéficié à l’augmentation du niveau de vie des salariés, le rapport se fait désormais clairement en leur défaveur.
Olivier Godechot :
Après l’attaque contre l’analyse des réseaux par laquelle Boltanski avait clos son intervention, le débat autour des relations entre réseaux et classes sociales comme schèmes d’explication ne pouvait pas manquer de rebondir avec l’intervention d’Olivier Godechot, puis ensuite avec celle d’Emmanuel Lazéga.
Olivier Godechot commence son propos en indiquant que le sujet « Réseaux et classes sociales » sonne comme un sujet de dissertation, qui a d’ailleurs suscité des polémiques l’année dernière, au moment de l’introduction de la question des « réseaux sociaux » dans les programmes de l’enseignement secondaire de sciences économiques et sociales (voir mon billet ici). Il y a l’idée que les réseaux sociaux véhiculeraient une représentation irénique du social, sans frontières de classes ni rapports sociaux conflictuels. Mais procéder ainsi, c’est réduire la question des réseaux à celle de la sociabilité, en s’appuyant sur une littérature scientifique qui commence à être datée.
Dans les travaux fondateurs, il y a pourtant une très forte relation entre les questions de classes et les questions de réseaux. Chez les économistes, dès l’origine, par exemple chez Quesnay, la distinction de différentes classes sociales s’appuie sur une conception spécifique d’un système relationnel, en l’occurrence celui que constituent les échanges marchands. On peut dire exactement la même chose de l’approche marxiste des classes sociales, qui est très clairement une approche relationnelle. Ensuite, dans l’anthropologie structurale, les principes de différenciation sociale sont très clairement construits sur des systèmes de relations. Il y avait donc tous les éléments dans les sciences sociales pour construire des relations entre des systèmes de groupement et des systèmes de mise en relation.
On aurait donc pu s’attendre à ce que l’analyse des réseaux vienne apporter de l’eau au moulin d’une approche classiste des structures sociales. Or, c’est plutôt le contraire qui s’est produit, et cela s’observe dès l’origine, dans le fameux inaugural de John Barnes (1954). Parti à la recherche des classes sociales, l’ethnologue dit avoir trouvé des réseaux. A partir de là, certains ont fait des réseaux sociaux une machine de guerre contre les classes sociales, comme le fait par exemple Maurizio Gribaudi dans ses « exercices sur les réseaux sociaux » (1998), comme le fait effectivement Harrison White dans les travaux déjà mentionné ce matin par Boltanski, ou encore comme le font Padgett et Ansell dans le non moins fameux article proposant une explication réticulaire de l’ascension au pouvoir des Médicis (1993).
Cela étant dit, à partir des années 90, on a vu apparaître de nouvelles formes d’articulation possibles entre classes et réseaux : d’où vient la position dans le réseau ? Comment le réseau se forme-t-il ? Qu’est-ce que l’homophilie, et comment l’expliquer ? Ces questionnements ont réintroduit le loup dans la bergerie, les attributs dans les relations, les classes sociales dans les réseaux sociaux.
Emmanuel Lazéga :
Après l’intervention d’Olivier Godechot, Emmanuel Lazéga voudrait prolonger le propos en examinant ce que pourrait être une position « néo-structurale », qui s’efforcerait de construire un modèle d’interprétation des relations entre les niveaux micro-, méso- et macro-sociologiques. Ce que l’analyse des relations d’interdépendance entre les acteurs apporte, c’est la possibilité de penser en même temps l’interdépendance et le conflit, et de le faire de façon assez complexe.
Il n’est pas contestable que cette approche a cependant un potentiel critique sous-exploité. Or, l’analyse des réseaux permet de distinguer les ressources relationnelles des individus, et la dimension collective de ce « capital social » des relations : des formes de solidarité, mais aussi des formes d’exploitation, d’accaparement, d’exclusion. On peut donc utiliser ces méthodes pour analyser les formes de la domination, du contrôle social, etc. La domination est bien une forme relationnelle, elle est donc pleinement justiciable d’une analyse en termes de réseaux, qui a donc des vertus heuristiques, y compris dans une perspective critique, et donc on ne peut plus en rester à la critique adressées par Boltanski aux travaux fondateurs de White : il s’est depuis écoulé 35 ans pendant lesquels l’analyse des réseaux a développé des outils permettant de penser cela de façon complexe, par exemple avec les travaux sur les transformations des réseaux menés par Tom Snijders.
En conclusion de son intervention, Emmanuel Lazéga est ainsi amené à suggérer que les interactions entre les « réseaux » (il préfère parler de systèmes d’interdépendance) et les classes sociales peuvent être pensées de façon fructueuse à travers la notion d’accaparement des opportunités développée par Charles Tilly (2005), dans les dernières années de sa vie, et justement au contact d’Harrison White à Columbia. A l’échelle macrosociologique, la société est une société organisationnelle, dans laquelle on « s’en sort » en s’organisant collectivement pour occuper ou atteindre des positions à partir desquels il est possible d’accaparer des opportunités : pas seulement des ressources, mais d’abord des possibilités d’y accéder sans trop de difficultés, quand on en a besoin, ce qu’on ne peut pas faire tout seul : des emplois, des finances, des appartements, des places en crèche… Toutes ces choses-là se font de façon collective, mais informelle, et l’analyse des réseaux est en capacité, méthodologiquement, de penser ce niveau-là d’articulation entre les différents niveaux des processus sociaux.
Références bibliographiques
Barnes J. A. (1954), « Class and Committees in a norwegian Island Parish », Human Relations, 7, pp. 39-58.
Baudelot Christian et Establet Roger (1971), L’école capitaliste en France, Paris, François Maspéro
Beaud Stéphane (2007), « La gauche et les classes sociales : de l’éclipse au renouveau », Mouvements, n° 50, pp. 66-78.
Boltanski Luc et Chiapello Eva (1999), Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, coll. « nrf essais »
Boorman Scott A. et White Harrison C. (1976), « Social Structure from Mutliple Networks II : Role Structures », American Journal of Sociology, 81, pp. 1384-1446.
Brousse Cécile, De Saint-Pol Thibaut, Gleizes François, Le Ru Nicolas, Marical François, Monso Olivier et Wolff Loup (2010), Assessment of the European socio-economic classification prototype (EseC) : lessons from the French experience, INSEE, coll. « Document de travail de l’Insee », n° F1006. Disponible en ligne: http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/docs_doc_travail/docf1006.pdf
Gribaudi Maurizio (dir.) (1998), Espaces, temporalités, stratifications. Exercices sur les réseaux sociaux, Paris, EHESS
Padgett John F. et Ansell Christopher K. (1993), « Robust action and the rise of the Medici, 1400-1434″, American Journal of Sociology, Vol. 98, No. 6., May, pp. 1259-1319.
Pincon Michel et Pincon-Charlot Monique (1989), La vie dans les beaux quartiers, Paris, Seuil
Pinçon Michel et Pinçon-Charlot Monique (2010), Le président des riches : Enquête sur l’oligarchie dans la France de Nicolas Sarkozy, Zones
Tilly Charles (2005), Identities, boundaries and social ties, Boulder/London, Paradigm Publishers
White Harrison C., Boorman Scott A. et Breiger Ronald L. (1976), « Social Structure from Multiple Networks : I. Blockmodels of Roles and Positions », American Journal of Sociology, 81, pp. 730-780.
[edit]
14/10/2011
Dans les références bibliographiques rassemblées ci-dessus, je n’ai évidemment pas pu mentionner toutes celles qui furent mobilisées par l’un-e ou l’autre des intervenant-e-s de cette journée d’études. Mais il y en a une qui a été évoquée par plusieurs d’entre eux, et que j’ai oublié de mentionner, ce qui est d’autant plus impardonnable que ce très bon article est en prise directe avec les questions discutées ci-dessus. Il s’agit de :
Pierru Emmanuel et Spire Alexis, « Le crépuscule des catégories socioprofessionnelles », Revue française de science politique, 2008/3 Vol. 58, p. 457-481.
Etant donnée la durée de la barrière mobile de la RFSP, Il devrait être accessible en ligne gratuitement au printemps 2012, mais en attendant vous pouvez en trouver déjà le résumé ici :
http://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2008-3-page-457.htm
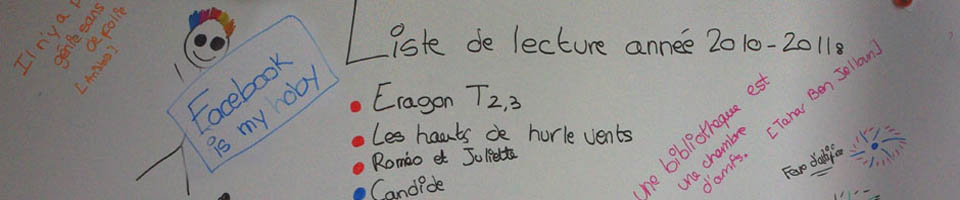














{ 3 commentaires… lisez-les ci-dessous ou ajoutez un commentaire }
{ 1 trackback }